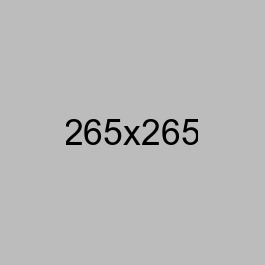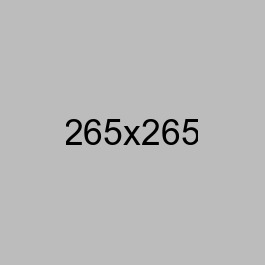Permalien :
Contribution à la culture des espèces de microalgues d'eau douce à intérêt aquacole
- Date_TXT
- 2013-01-01
- Cote
- 579.832 KHE/M
- Type de document
- Thèse
Description :
En raison de la diversité des écosystèmes en l'Algérie, une importance flore aquatique se répartit sur les différentes zones humides du pays. Cette richesse floristique est constituée de différentes espèces végétales, parmi lesquelles : les microalgues.
Une telle diversité, non exploitée, constitue un réel potentiel pour la recherche et l'industrie. Les microalgues sont des organismes microscopiques et photosynthétiques. Leur taille varie du micron à la centaine de microns. Elles se trouvent en abondance dans les milieux aquatiques (océans, rivières, lacs, etc.). Elles représentent le point de départ de la chaîne alimentaire et constituent le premier maillon de la production primaire (Audineau, 1985).
Ces dernières années, la culture de microalgues, plus particulièrement les espèces de la famille des chlorophycées, a reçu beaucoup d'attention en raison de leur utilité dans divers domaines (aquaculture, pharmacie, alimentation humaine, énergie renouvelable.....etc.) (Borowitzka, 2011).
Le présent travail consiste en la culture de deux espèces de microalgues autochtone d'eau douce (Chlamydomonas sp et Scenedesmus sp), isolées à partir du lac El- Goléa de Ghardaïa. Ce travail rentre dans le cadre des activités du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA) qui porte sur « la sélection et l'optimisation des conditions de culture des microalgues d'eau douce à intérêt aquacole ».
Ce manuscrit est composé de trois principales parties, la première comporte une synthèse bibliographique divisée en trois chapitres : le premier renferme des généralités sur les microalgues. Le deuxième chapitre décrit les espèces étudiées de la famille des chlorophycées. Le troisième chapitre est consacré à la culture des microalgues dont les différents modes de culture et les principaux facteurs influençant la croissance de la biomasse. La deuxième partie, matériels et méthodes décrit en détail les méthodes adoptées pour effectuer ce travail y compris l'identification et la purification des deux espèces, procédure de la mise en route de la culture et enfin les analyses biométriques et biochimiques ayant lieu pour quantifier et caractériser la biomasse microalgale.
Les résultats obtenus ainsi que les discussions fournies sont assemblés dans la troisième partie du document.
Cette étude s'achève par une conclusion.

 French
French